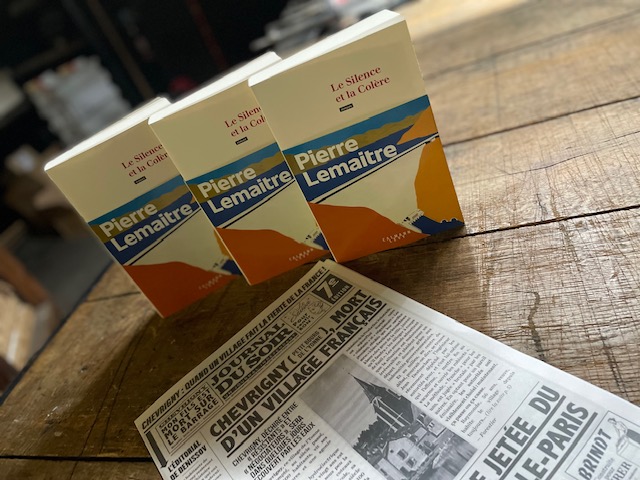Rencontre avec Fabrice Midal à l’occasion de la parution de son nouvel ouvrage, La théorie du bourgeon, aux éditions Flammarion/Versilio.
J’ai une formidable nouvelle pour chacun d’entre vous
J’ai une formidable nouvelle pour d’entre vous : vous ne serez jamais zen, calme, jamais insensible, jamais éveillé, cela n’existe pas. Lié à cela, vous ne serez jamais absolument performant comme une intelligence artificielle, vous n’avez aucune chance, contre les robots vous n’avez aucune chance.
Et c’est une très bonne nouvelle
Et c’est une très bonne nouvelle, car c’est parce que vous êtes des êtres humains. Être un être humain c’est pouvoir être touché, c’est pouvoir aimer, c’est pouvoir être vivant. Et la théorie du bourgeon, c’est essayer de célébrer le fait que nous soyons vivants. Et aujourd’hui, c’est plus que jamais important.
Et c’est cela qui peut nous libérer du découragement
Et c’est cela qui peut nous libérer du découragement. Arrêter de vouloir être autrement que nous sommes : des êtres humains.
Ce livre c’est un peu un tournant dans ma vie
Ce livre c’est un peu un tournant dans ma vie. Il faut quand même oser écrire une théorie. Donc il a fallu 40 livres pour oser écrire une théorie et avoir une pensée à la hauteur de notre temps.
J’ai vendu 1 million de livres
Il semblerait que j’aie vendu 1 million de livres. Cela m’a laissé sans voix. C’est invraisemblable, comment quelqu’un comme moi peut avoir vendu 1 million de livres ? Je suis tellement étrange ! Je n’aime pas les chansons et la variété mais j’adore Stockhausen qui n’intéresse absolument personne, je n’ai jamais lu un seul des romanciers à la mode, j’en suis resté à Proust et Kafka, je passe ma vie dans les musées à regarder l’œuvre de Nicolas Poussin et de la modernité, et je me disais comment se fait-il que n’aimant absolument pas ce qui marche, n’ayant jamais regardé la télévision, j’aie ce succès.
Il y a 2 raisons qui expliquent peut-être ce million d’exemplaires vendus
Je crois que je suis animé par le Dieu Eros qui ne me laisse absolument aucun répit. Du matin au soir, je me demande ce que je peux faire dans ce monde pour qu’il y ait un peu plus d’amour et un peu plus de lumière. Et je pense que c’est ça qui, malgré mon handicap, m’a permis d’écrire des livres qui parlent à d’autres. Le deuxième point c’est la chance des rencontres. Si mes livres rencontrent leur public c’est la chance de nombreuses rencontres, dont celle avec mon professeur de philosophie.
Le livre : La théorie du bourgeon
Présentation de l’éditeur : Le découragement est le problème majeur de notre temps. Là où nous pourrions avancer, nous baissons les bras. Là où nous pourrions être victorieux, nous partons perdants. On nous a fait croire que nous devions être dans le contrôle permanent, dans l’efficacité absolue. Mais la vie ne se contrôle pas, elle ne se gère pas. Comment inverser le mouvement ? Comment retrouver l’élan pour sortir de la paralysie qui nous guette, pour rejoindre enfin le monde et essayer de le réparer ? Se fondant sur les enseignements de philosophes qui, comme Nietzsche, Bergson ou Hannah Arendt, ont affronté ce péril majeur avec lucidité, Fabrice Midal nous amène à reprendre confiance en nous et en l’humanité. Avec La théorie du bourgeon, il nous apprend à cultiver la vie dans son surgissement, ce bourgeon qui réside en nous et qui ne demande qu’à croître pour donner des fleurs, pour donner des fruits. C’est ce remède anti-découragement que je vous invite à découvrir.