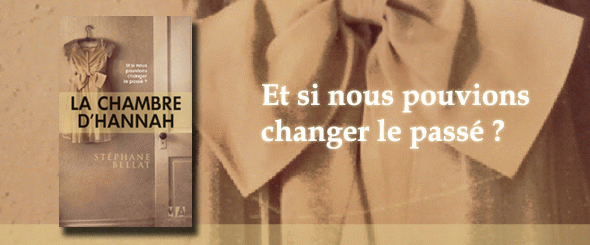Dimanche 22 mars dernier, David Foenkinos a accepté de se prêter avec une ineffable gentillesse et l’inénarrable humour qui le caractérise à une rencontre avec ses lecteurs, dans le cadre des conférences du Salon du livre de Paris.
Rencontre privilégiée avec l’auteur :
Revenons sans tout reprendre en détail, sur votre parcours. Vous avez fait beaucoup d’autres livres avant La tête de l’emploi, dont un premier roman, « Inversion de l’idiotie : de l’influence de deux polonais », en 2001 chez Gallimard. Vous avez reçu le prix Roger Nimier avec « Le potentiel érotique de ma femme » en 2004. Il y a eu « La délicatesse » qui en 2009 vous a porté au sommet de ces auteurs qui sont si largement aimés. Mais aussi, sans tous les citer, Lennon, Nos séparations, En cas de bonheur, Les souvenirs, Je vais mieux, et, récemment, La tête de l’emploi. Quels sont les auteurs qui vous ont influencé ?
David Foenkinos : Je pense que tout écrivain est le fruit des lectures qui l’ont influencé. Dans ma vie au quotidien sont majeurs les écrivains tels Kundera, Philippe Roth, mais aussi la littérature russe, celle des pays de l’est. Ou encore Albert Cohen ou Romain Gary.
Votre roman repose sur un personnage, Bernard. Vous êtes obligé de parler du prénom.
DF : On savait que pour Bernard cela allait mal se passer. Il y avait une sorte d’autoroute du Bernard qui faisait que le roman était limpide, déjà là. J’ai toujours été très excité par les clichés, par ce que peuvent véhiculer les prénoms ou les pays. J’ai toujours aimé les raccourcis, évidemment ils sont souvent de mauvaise foi, ils sont faux. Quand je voyage je demande qu’on m’explique tous les clichés véhiculés à travers une nationalité. En Hongrie, ils sont par exemple toujours déprimés avant même de recevoir la nouvelle. Ils sont en avance sur leur propre déprime. Donc Bernard on peut comprendre que ce n’est pas un prénom gagnant, qu’il y a un potentiel de l’échec.
En même temps on sent qu’il y a tout du long une tendresse réelle pour ce personnage, pour ses côtés ridicules.
DF : C’est un livre sur la crise, sur une succession de difficultés, sur la brutalité dans la vie professionnelle, né d’un reportage que j’ai vu à la télévision. Je l’ai tout de suite pensé en termes de comédie. J’ai tout de suite vu un homme de 50 ans qui retournait à la case départ, vivre chez ses parents et qui se faisait engueuler car il ne se brossait pas les dents le soir. Un type obligé de regarder avec ses parents Questions pour un champion tous les jours et Des chiffres et des lettres avant, Des chiffres et des lettres que j’estime être une forme de préliminaires orgasmiques à Questions pour un champion. (rires) On sent qu’il a une fragilité ontologique, liée au fait que ses parents l’ont élevé comme on élève un mollusque, à l’idée que ses parents ont fait un enfant comme on fait une expérimentation. Ce qui m’a intéressé, c’est que la crise de Bernard va permettre à tous les personnages, y compris aux parents, de commencer à réfléchir sur eux-mêmes, de se remettre en question. Finalement il va embarquer tout le monde dans son histoire. La crise de Bernard va être contagieuse.
C’est peut-être aussi une question de génération. Si Bernard semble si désillusionné, c’est aussi que lui, comme ses parents, était dans l’idée qu’il était assuré de garder son travail, de rester en couple tant bien que mal,de traverser les années sans changement majeur. Or tout s’écroule dans l’époque contemporaine : crise de la famille, crise du travail.
DF : Oui. Bernard est acculé pour la première fois de sa vie à devoir ne plus se reposer sur ce qu’il est. Il doit prendre des risques, inventer, se modifier. Ce livre, outre l’aspect comédie, c’est l’histoire d’un homme qui va devoir retourner à la case départ, qui n’a pas forcément les armes et va devoir aller les chercher. C’est alors qu’il va découvrir qu’il a un potentiel insoupçonné en lui, une grande capacité au rebond. J’aime l’idée que face à la brutalité de ce monde, on ait en soi des possibilités de rebondir. Il va recommencer une nouvelle vie et non « refaire » sa vie. Refaire sa vie : c’est une expression qui est tellement dans le langage commun mais que je trouve si terrible. Refaire sa vie ça veut dire quoi, qu’on a raté la première, qu’il faut tout refaire ? Non, on ne refait pas les choses, on les continue avec l’expérience de nos échecs.
Dans le film d’Etienne Chatillez, Tanguy, cela faisait beaucoup rire qu’à 30 ans on soit toujours chez ses parents. Maintenant on rit plus jaune car non seulement les enfants sont toujours chez leurs parents à 30 ans mais ils y reviennent à 50 ! On n’a plus que 15/20 ans de tranquillité en tant que parents !
DF : Oui, avec ce phénomène de société, il faut savoir ce que cela implique de faire des enfants (rires).
Il y a beaucoup d’inconvénients à retourner vivre à 50 ans chez ses parents, surtout quand ils sont si rigides.
DF : Oui, on est dans une sorte de mausolée de la vieillesse. Ses parents sont figés. Et Bernard va les propulser dans sa crise. Leur rigidité va fléchir. On marche sur des patins à la maison, comme s’il fallait survoler les jours, ne pas laisser de traces, glisser. Et enfin ils vont froisser leur quotidien, et c’est ça qui est intéressant. Ce qui m’intéresse dans un roman, c’est de commencer avec des clichés, une forme de grossièreté narrative y compris ici dans le caractère de Bernard, dans qui il est. Pour moi je ne suis pas du tout dans la finesse au début du livre, Bernard est presque du carton-pâte. L’avancée du roman, l’excitation du roman, c’est de progresser dans la finesse (finesse psychologique, finesse des situations) pour qu’elle devienne plus complexe. On affine le personnage progressivement, sans en faire un parangon de subtilité, mais on s’attache à lui, on le voit capable de mener sa vie de façon un peu plus habile.
Une des grandes vertus de ce livre est qu’il peut être lu à plusieurs niveaux. C’est un des paradigmes du plaisir de lecture.
DF : Oui, c’est une comédie légère sur la crise, mais pas seulement. Il y a plusieurs degrés de lecture. Ce qui m’intéresse c’est de travailler les profondeurs cachées d’une histoire.
Propos recueillis le 23/03/2014. ©Karine Fléjo